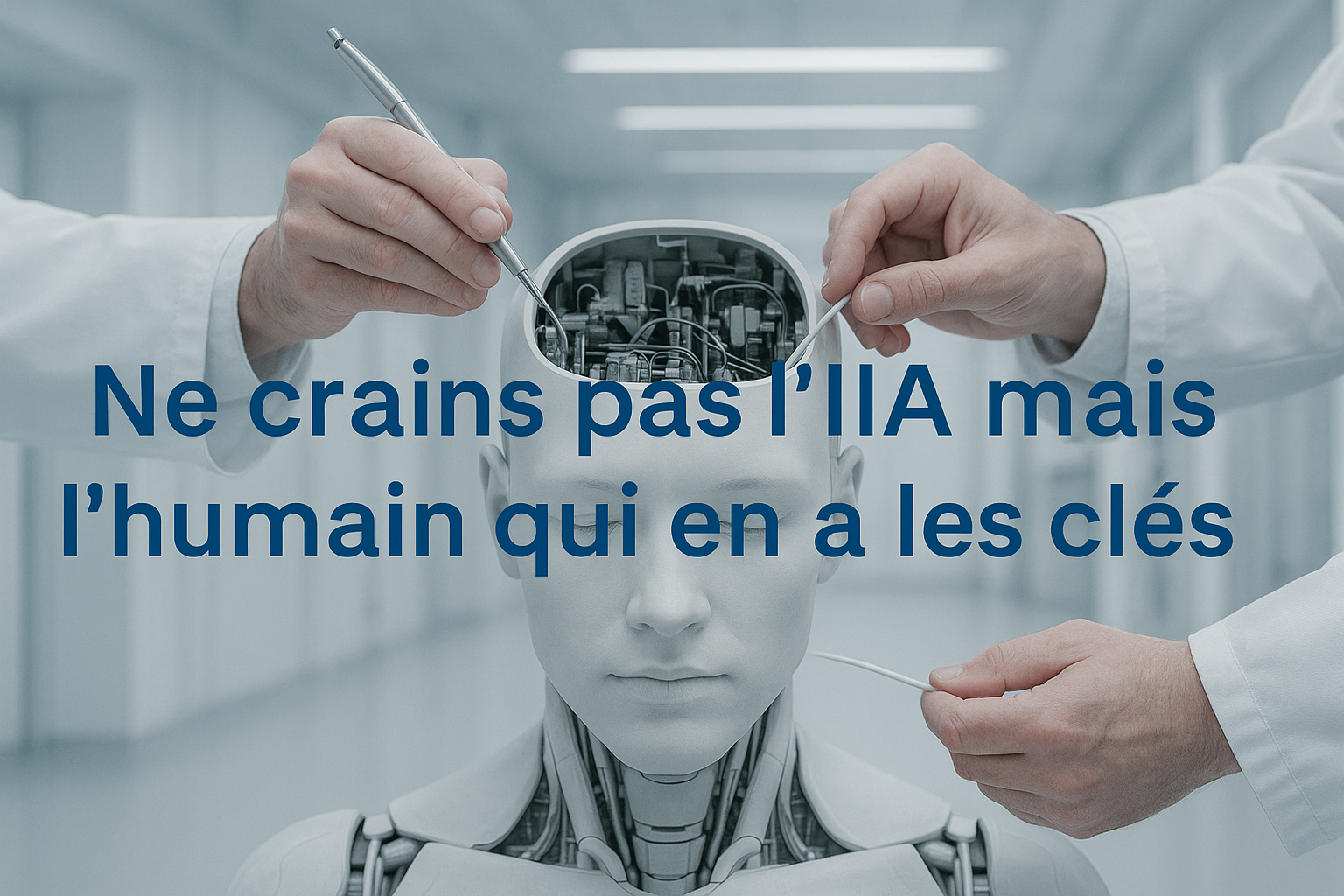

Intelligence Artificielle : Pas de fantôme dans la Machine, les clés sont entre Nos Mains !
Pour contextualiser notre sujet, une exploration des concepts d’intelligence et de conscience est un prérequis essentiel.
Il convient de noter une distinction sémantique fondamentale entre les acceptions française et anglaise du terme « intelligence« . Dans le monde anglo-saxon et divers contextes techniques, il s’assimile à la pratique du renseignement (intelligence). Il désigne alors concrètement la collecte, le traitement, la diffusion et la protection d’informations stratégiques, comme l’illustrent les expressions « economic intelligence » ou « technological intelligence ». Cette définition revêt une dimension purement fonctionnelle, opérationnelle et pragmatique.
En français, le mot « intelligence » recouvre un spectre plus large de facultés cognitives supérieures, incluant l’analyse, la compréhension, le discernement et la capacité à distinguer le vrai du faux. Il englobe également l’aptitude à élaborer des concepts, à en vérifier la cohérence et peut s’étendre à l’intuition, l’émotion ou encore l’intentionnalité issue de la conscience.
Or, une machine est, à ce jour, manifestement dépourvue de ces attributs. Par conséquent, le terme « cybernétique » me semble apparaître comme une traduction plus fidèle du concept anglo-saxon que l’expression « intelligence artificielle ». Cette dernière, bien que commercialement percutante, n’est pas récente. Elle fut conçue dans les années 1950 par le mathématicien et pionnier de l’informatique Alan Turing , qui a ainsi élaboré un concept attractif pour valoriser ses recherches.
Aux fondements de l’IA: Une incompréhension préjudiciable.
Il est impératif de souligner que l’emploi banalisé, voire galvaudé, du terme « Intelligence Artificielle » pour qualifier des réalités hétérogènes et parfois contradictoires, tend à obscurcir le débat public. Cette confusion terminologique s’avère particulièrement préjudiciable lorsqu’est abordée la perspective d’un dépassement des capacités humaines par la machine.
À ce titre, une distinction fondamentale s’impose. L’Intelligence Artificielle Généraliste (AGI), seule technologie qui serait susceptible de surpasser l’intellect humain, demeure à ce jour un champ de recherche prospectif. L’avènement hypothétique de cette AGI est communément désigné par le concept de « singularité technologique ».
Les systèmes actuellement opérationnels appartiennent à une autre catégorie : celle des intelligences artificielles dites génératives et ultraspécialisées. Celles-ci excellent dans des domaines d’application circonscrits. On peut notamment citer ChatGPT pour la génération textuelle, Julius pour les mathématiques, Midjourney ou Dall-E pour la création d’images, ou encore Kling.AI et Suno.AI pour la production vidéo et musicale. Il existe une multitude d’autres systèmes similaires, adaptés à des activités aussi variées que la recherche fondamentale ou la production industrielle.
L’Intelligence Artificielle en Pratique : Nature, Mécanismes et Limites Actuelles
Le paradigme de fonctionnement de ces systèmes cybernétiques repose sur des processus computationnels intensifs, alimentés par de vastes corpus de données. La qualité des résultats générés est donc directement conditionnée par l’accès et la richesse de ces données fondatrices. Un modèle comme ChatGPT, par exemple, opère de manière agnostique sur le plan sémantique ; la notion de « mot » lui est étrangère. Son architecture lui permet d’établir des corrélations statistiques complexes au sein de ses données d’entraînement, un traitement qui demeure fondamentalement dépendant des algorithmes et des données brutes.
Dans cette perspective, l’IA générative s’apparente à une forme de mimétisme de l’intelligence. Sa capacité à produire des corrélations inédites peut certes susciter l’étonnement et donner l’illusion d’une réflexion structurée, mais le résultat n’est que le produit de calculs. La perception d’une intelligence ou d’une conscience au sein de la machine relève d’un biais d’anthropomorphisme, où l’utilisateur projette ses propres facultés sur le système.
Plusieurs limites fondamentales doivent être rappelées. L’intervention humaine reste, à ce jour, indispensable à l’apprentissage supervisé de ces IA. De plus, l’efficience de l’apprentissage humain contraste fortement avec celle des machines : un enfant distingue rapidement des objets après quelques exemples, là où une IA requiert l’analyse de milliers d’images. Enfin, la notion de créativité suppose une conscience de l’acte créateur. Or, en l’absence d’une définition scientifique ou philosophique établie de la conscience, il est impossible d’attribuer une telle faculté à une machine.
Si l’IA surpasse déjà l’humain dans des tâches hautement spécialisées, l’être humain se distingue par sa polyvalence. L’IA est donc un outil d’assistance puissant, qui souligne l’importance de préserver nos compétences transversales. Une autre limite majeure est sa consommation énergétique. La victoire d’AlphaGo sur le champion du monde de Go est emblématique : bien que performant, le système a consommé près de 50 000 fois plus d’énergie que le cerveau de son adversaire humain. Cet ordre de grandeur impose de reconsidérer la définition même de la performance.
Cette problématique énergétique est d’autant plus préoccupante que des interrogations subsistent quant à la pérennité de la loi de Moore. Un éventuel plafonnement de la puissance de calcul, couplé à la multiplication des usages de l’IA, pourrait engendrer une inflation de la consommation électrique de ces technologies.
Le glissement sémantique de l' »intelligence » et la primauté contestée de la donnée sur la théorie
Ma première inquiétude porte sur l’incompréhension des termes liés à l’Intelligence Artificielle et sur les usages insuffisamment maîtrisés de cette technologie. Comme mentionné ci-dessus, les IA génératives ne font que manipuler des données issues de bases de données. La qualité des réponses est donc directement liée à celle des dites databases et de leur accessibilité (pratique et juridique par exemple).
En employant le terme « d’intelligence », l’idée qu’une IA pourrait élaborer une théorie progresse insidieusement. Cela peut paraître anodin, mais en poussant le raisonnement cela sous-entend que la donnée primerait sur la théorie, et donc sur le raisonnement et l’abstraction
Intelligence Artificielle : Points de Vigilance et Inquiétudes Majeures

La dévalorisation de la théorie : entre reconnaissance scientifique et questionnement sur l’origine des savoirs
Un indicateur notable de cette tendance pourrait être l’attribution du prix Nobel de physique 2024 à deux pionniers de l’intelligence artificielle, John J. Hopfield et Geoffrey Hinton, pour leurs travaux sur les réseaux de neurones artificiels et l’apprentissage automatique. Cette reconnaissance, bien que saluant des découvertes fondamentales, interroge : traduit-elle une pénurie de physiciens théoriciens méritants, ou symbolise-t-elle une relégation de la théorie au profit de l’exploitation des données existantes ?
Cette seconde perspective est préoccupante, car elle semble ignorer que les données ne préexistent pas de manière autonome. Historiquement, ce sont les grandes théories, fruits de l’abstraction et du raisonnement, qui ont orienté la recherche et permis, par leur vérification expérimentale, de générer les corpus de données qui alimentent aujourd’hui les intelligences artificielles.
La question de la pérennité de ce modèle se pose alors avec acuité. Si les IA se mettent à utiliser les données qu’elles génèrent elles-mêmes, ne risque-t-on pas d’entrer dans un cycle d’auto-contamination ? Un tel système en boucle fermée pourrait voir des contenus non validés devenir des sources, érodant ainsi progressivement la fiabilité du savoir.
Cette crainte d’une « fin de la théorie » n’est pas qu’une hypothèse. Elle a été explicitement formulée par des figures d’influence telles que Chris Anderson, rédacteur en chef de la prestigieuse revue Wired, qui a posé la question de la pertinence future du théoricien face à la puissance de l’analyse de données.
Limites conceptuelles de l’IA : de l’abstraction à la responsabilité, vers un possible affaiblissement scientifique
Il est illusoire de croire que l’intelligence artificielle aurait pu, seule, permettre la découverte du boson de Higgs. Comment aurait-elle pu déterminer la pertinence des données sans le cadre théorique préalablement établi par les physiciens ? Il convient de rappeler que les données qui alimentent les technologies de demain sont elles-mêmes issues des équations de la physique quantique, formulées entre 1900 et 1930.
Cela met en lumière une limite fondamentale : jusqu’à preuve du contraire, une IA est incapable de l’effort d’abstraction nécessaire à l’élaboration d’un concept. Elle ne peut ni formuler une hypothèse de manière autonome, ni engager un raisonnement contrefactuel du type « que se passerait-il si ? ».
Or, l’acte de « penser » est indissociable de la prise de risque et de la responsabilité intellectuelle. À quel moment une machine assumera-t-elle la responsabilité de ses productions ? De fait, lorsque des IA génèrent des réponses erronées ou des « hallucinations », la responsabilité juridique et éthique incombe systématiquement aux entreprises et aux humains qui les supervisent.
Par conséquent, affirmer qu’une machine « pense » ou lui attribuer un QI, comme le suggèrent certaines personnalités publiques influentes, semble non seulement peu convaincant mais aussi préoccupant.
Cette analyse mène à ma crainte principale : le risque d’assister à un affaiblissement de la science et du savoir, au profit d’un oligopole qui détiendrait les clés de l’intelligence artificielle.

L’indiscernabilité du vrai et du faux : l’IA comme puissant vecteur de désinformation
Ma seconde inquiétude majeure découle d’une caractéristique fondamentale de l’IA : son incapacité intrinsèque à distinguer le vrai du faux. Cette amoralité cognitive en fait un vecteur potentiellement redoutable pour la désinformation de masse. Dans l’écosystème numérique, contenus fallacieux et informations véridiques coexistent souvent avec une légitimité et une visibilité apparentes identiques. La charge du discernement est ainsi entièrement reportée sur l’utilisateur.
Celui-ci doit alors statuer, sous l’influence de ses propres biais psychologiques et émotionnels, un phénomène que des effets comme l’effet ELIZA peuvent amplifier de manière vertigineuse. Il est ici crucial de distinguer la « décision » du « choix ». Une machine peut prendre une décision en appliquant un ensemble de règles et d’algorithmes. Le choix, en revanche, est un acte qui engage la responsabilité de l’individu, surtout lorsque le contexte est ambigu et sujet à interprétation.
La question de l’imputabilité de la machine demeure donc entière : qui assume la responsabilité d’une erreur et selon quels critères ?
Plus fondamentalement, l’IA est et reste une création humaine, porteuse de l’idéologie de ses concepteurs. Le risque est de développer une forme de dépendance, proche de l’idolâtrie, qui menace les libertés fondamentales. Par le biais d’un soft power d’autant plus efficace qu’il se masque sous une apparente bienveillance, il devient possible de manipuler les choix des individus à leur insu, un danger particulièrement saillant dans les contextes d’incertitude.
Le piège des algorithmes : enfermement, biais de confirmation et érosion de la pensée critique
Pour qui douterait de ce constat, il suffit de considérer la puissance des algorithmes actuels, qui parviennent à modéliser nos comportements avec une précision parfois supérieure à notre propre introspection. Ces systèmes agissent comme un miroir de nos désirs, avec pour effet de nous enfermer dans des bulles algorithmiques qui peuvent se révéler néfastes. En nous détournant de l’altérité, ils favorisent une forme d’isolement social, un phénomène déjà préoccupant qui touche une part croissante de la population.
Le mécanisme est subtil : les choix proposés par ces systèmes sont systématiquement calibrés pour correspondre à nos préférences, nous confinant ainsi dans nos propres schémas de pensée. Cette boucle de rétroaction est conçue pour entretenir les biais cognitifs, au premier rang desquels figure le biais de confirmation.
Or, l’exercice de l’esprit critique suppose une démarche inverse : il requiert la capacité de penser « contre soi-même » et de remettre en question ses propres certitudes. L’intelligence artificielle, dans son application actuelle, nous incite précisément au contraire. La source de la crainte ne réside donc pas dans la technologie elle-même, mais bien dans les intentions de ceux qui la programment et en détiennent le contrôle.
L’Avenir avec l’IA : Entre Craintes de Domination et Impératif d’Éducation
En conclusion, il est manifeste que les intelligences artificielles actuelles ne sont qu’une préfiguration des technologies à venir. Comme nous l’avons souligné, l’intelligence artificielle généraliste (AGI), susceptible de surpasser les capacités humaines dans tous les domaines, n’est pas encore une réalité. Les technologies numériques et silicées d’aujourd’hui sont dépourvues de conscience et ne constituent en rien des formes de vie ; elles demeurent de puissants outils exécutant les tâches pour lesquelles elles ont été programmées.
Si les IA génératives connaissent une évolution rapide et des performances croissantes, leurs limites intrinsèques sont tout aussi patentes, notamment leur dépendance cruciale à la qualité et à l’accessibilité des données.
Il convient de garder à l’esprit que l’humanité n’a jamais attendu l’IA pour s’engager dans des entreprises destructrices ; la responsabilité première incombe donc à l’utilisateur, et non à l’outil. Par conséquent, un impératif d’éducation et d’acculturation à ces technologies s’impose. C’est la condition sine qua non pour maîtriser les risques, saisir les opportunités et s’assurer que leur développement demeure au service de l’humanité. C’est à cette condition que nous pourrons conserver une confiance éclairée en l’avenir.

